

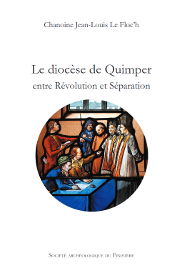
|
Le diocèse de Quimper entre Révolution et Séparation
Chanoine Jean-Louis Le Floc'h 2022 |
Archiviste diocésain de Quimper et Léon de 1973 à 1996, le chanoine Jean-Louis Le Floc’h
se passionne vite pour l’histoire religieuse locale, particulièrement celle de son pays
bigouden natal.
Comme ses prédécesseurs, il devient vice-président de la
Société archéologique du Finistère en 1976, est décoré des palmes académiques
dans les locaux de l’université de Brest où il est intervenu à plusieurs reprises
comme membre de jury de maîtrise d’histoire.
Dans le Bulletin de la Société archéologique du Finistère il rédige plusieurs articles fondateurs sur la période révolutionnaire, le clergé constitutionnel, les reconquêtes du catholicisme au XIXe siècle. Au fil des colloques universitaires, des événements de la vie de l’Église locale, il publie de nombreux textes dans des volumes d’actes, le bulletin diocésain Quimper et Léon, les bulletins paroissiaux. Sa bibliographie compte 113 références. Le présent recueil propose au lecteur un choix de ces textes publiés sur des supports parfois difficilement trouvables aujourd’hui. Il se concentre autour des périodes de la fin de l’ancien régime, de la Révolution de 1789 en Finistère, du renouveau spirituel au XIXe siècle, mais aussi de l’aspect particulier de l’Eglise et de la langue bretonne, et de diverses figures de prêtre. L’ensemble de ces textes rassemblés brosse une image renouvelée de l’histoire du diocèse pendant la Révolution et au XIXe siècle. |
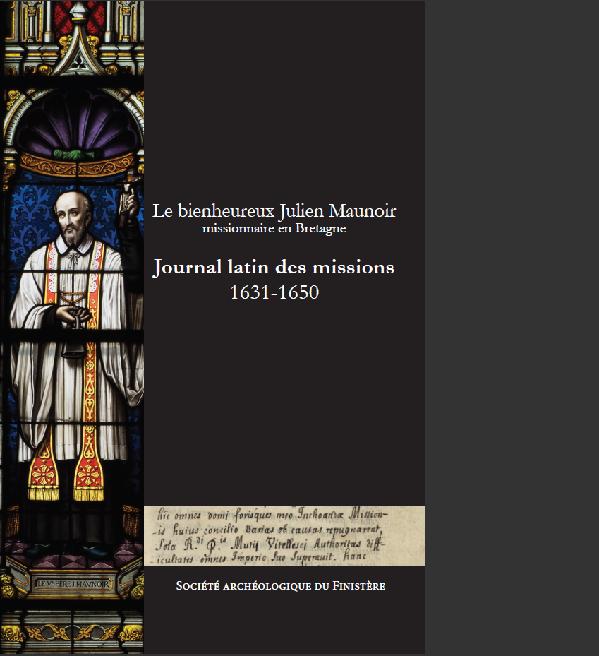
|
Le bienheureux Julien Maunoir missionnaire en Bretagne. Journal latin des missions 1631-1650
Préfacé et édité par Hervé Queinnec. Texte latin traduit et présenté par Fañch Morvannou 2020 |
Né en 1606 à Saint-Georges-de-Reintembault (diocèse de Rennes), mort en 1683 à Pléven (haute Cornouaille, aujourd’hui dans le diocèse de Saint-Brieuc), béatifié en 1951, le père Julien Maunoir est l’une des grandes figures missionnaires de la Réforme catholique en Bretagne au XVIIe siècle. Missionnaire zélé, prédicateur infatigable, auteur de nombreux cantiques bretons, on lui doit plusieurs ouvrages en langue bretonne. En 2020, la Société archéologique du Finistère a publié le Journal latin des missions de Julien Maunoir et sa traduction par Fañch Morvannou. Écrit de 1631 à 1683, ce document est maintenant proposé sous la forme de pages doubles, latin et français. |
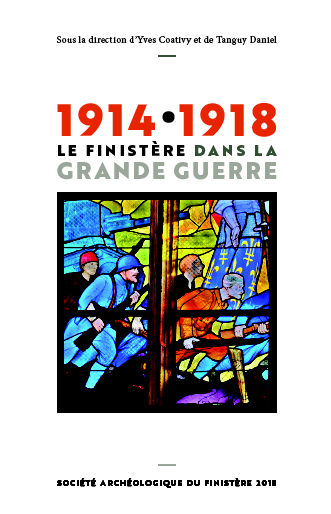
|
1914-1918. Le Finistère dans la grande guerre.
Sous la direction de Yves Coativy et de Tanguy Daniel 2018 |
En 2018, la Société archéologique du Finistère a décidé de consacrer exceptionnellement son bulletin à un
thème, la
commémoration de la fin du premier conflit mondial. Vous y trouverez une série d’articles
qui concernent les liens entre le Finistère et la Grande Guerre. Ils abordent, dans l’ordre alphabétique des
auteurs, des sujets aussi variés que la prostitution, les hôpitaux, les câbles sous-marins, les visites du
président
Wilson, etc. De la même façon que les éléments colorés du beau vitrail de la chapelle de Ty-Mamm-Doue
(Quimper)
donnent les clés du succès des dernières batailles de l´automne 1918, les éléments de cet ouvrage permettent
de
mesurer différents aspects du conflit en Finistère. Nous espérons qu´il permettra au lecteur de mieux
comprendre la
vie « à l’arrière » et de mesurer l’impact de combats lointains et mondiaux sur une des extrémités de
l’Europe.
Télécharger le bon de commande (fichier PDF) |
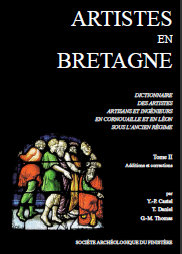
|
Artistes en Bretagne
Yves-Pascal Castel, Georges-Michel Thomas (décédé en 1991) et Tanguy Daniel 2013 |
Suite du tome I publié en 1987, le tome II du Dictionnaires des artistes, artisans et ingénieurs du Léon et
de
Cornouaille
sous l´Ancien Régime a été publié en novembre 2013 par la Société archéologique du Finistère.
On y trouve plus de 2000 références nouvelles. Les auteurs, l´abbé Yves-Pascal Castel, Georges-Michel Thomas
(décédé
en 1991) et Tanguy Daniel, y ont notamment intégré des notices fournies par Jean Tanguy, professeur à l´UBO,
René
Couffon
(1888-1973), auteur répertoire des églises et chapelles du diocèse de Quimper et Léon (notices remises par
Jacques
Charpy,
directeur des archives départementales du Finistère jusqu´en 1974).
Voir l´article du Télégramme Cliquer ici pour commander le Dictionnaires des artistes (tome I ou II) |
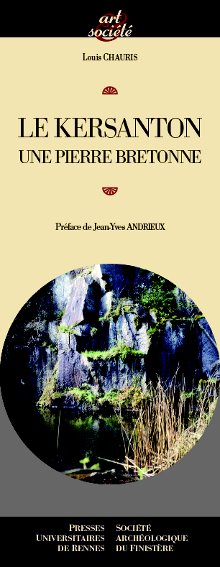
|
Le Kersanton une pierre bretonne
Louis Chauris
2010 |
En novembre 2010 la Société archéologique du Finistère a publié l´ouvrage de Louis Chauris "Le Kersanton une
pierre
bretonne".
Le kersanton – ou kersantite des géologues – tire son nom d’un hameau de la rade de Brest en Bretagne. Cette
roche
filonienne
intrusive,
d’origine profonde, a
été tôt
recherchée par suite de sa singulière aptitude au façonnement. Elle a permis la sculpture
des porches et calvaires dans les enclos paroissiaux entre les XVe et XVIIe siècles. Ultérieurement, elle a
été
appréciée
par l’art funéraire et, à l’issue de la Grande Guerre, lors de l’érection d’innombrables monuments aux morts
;
plusieurs
autres roches bretonnes, de teinte sombre, ont pu alors la concurrencer. Toutefois, le plus fort volume de
kersanton,
extrait dans la seconde partie du XIXe siècle et au début du XXe siècle, a été mis en œuvre dans l’habitat
et les
Travaux
publics (infrastructures portuaires, ferroviaires, militaires, construction des phares…). La situation des
principales
carrières en bordure de la rade de Brest facilitait son acheminement par voie d’eau. Les exploitations,
occupant
plusieurs
centaines de personnes, présentaient une organisation industrielle. Aujourd’hui, les sites abandonnés sont
noyés ou
comblés
; les quais d’embarquement s’écroulent ; les amoncellements de blocs rebutés sont envahis par la végétation…
Seule
la
restauration des monuments historiques pourrait raviver quelques carrières célèbres. Au total, la saga du
kersanton,
éclairée par de nombreuses photographies inédites dues à l’auteur, glisse insensiblement de l’Histoire
naturelle –
en
l’occurrence la Géologie – à l’Histoire et plus particulièrement à l’Histoire de l’art en Bretagne
occidentale.
Louis
Chauris, né à Morlaix en 1930, géologue, docteur-es-Sciences naturelles, est directeur de recherche au CNRS
(e. r.).
Cliquer ici pour commander le livre sur le kersanton |
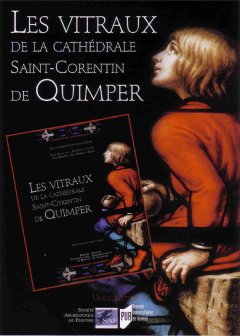 En décembre 2005 la Société
archéologique du Finistère avait également publié l´ouvrage intitulé
Les vitraux de la cathédrale Saint-Corentin de Quimper. Il a été écrit par A. Brignaudy, Y.-P. Castel, T.
Daniel
J. Kerhervé, J.-P. Le Bihan
En décembre 2005 la Société
archéologique du Finistère avait également publié l´ouvrage intitulé
Les vitraux de la cathédrale Saint-Corentin de Quimper. Il a été écrit par A. Brignaudy, Y.-P. Castel, T.
Daniel
J. Kerhervé, J.-P. Le Bihan
L´ouvrage peut être commandé au prix de 39 euros port compris à la Société archéologique du Finistère, BP 1156, 29101 Quimper
Autres ouvrages publiés par la Société:
Artistes en Bretagne
La Cornouaille du IXe au XIIe siècle
Sur les pas de Paul Aurélien
Histoire de Quimper
...
La Société publie un
bulletin d´environ 500 pages
structuré en rubriques principales.
Un tome commence par la rubrique
"Archéologie". A côté des notices d´archéologie finistérienne de l´année on trouve
des études plus complètes sur
certains lieux ou des synthèses. En 2001 on trouve par exemple une étude sur les thermes gallo-romains d´Armorique.
Une large place est réservée chaque année au patrimoine artistique. C´est la rubrique
"Patrimoine, art, histoire". Elle commence par les études et découvertes concernant
les monuments et objets d´art
du Finistère. Elle se poursuit par une description des dernières acquisitions du Musée départemental breton. Elle se
termine par une série d´articles, par exemple en 2003, "Les maisons à pans de bois de Quimper".
La rubrique "Histoire et Société" comprend des articles tels que "Les moulins de Plonévez-Porzay" (2001), "Histoire de la presse et de l´édition à Quimperlé" (2002 et 2003), ...
La rubrique "Langue et littérature bretonnes et celtiques" commence par une chronique de langue et de littérature bretonne. Elle se poursuit par une série d´articles tels que "L´étymologie du breton beleg, prêtre" (2004).
Le bulletin se termine par une chronique des archives et des bibliothèques du Finistère. On y trouve aussi des comptes rendus bibliographiques et les procès-verbaux des séances et des excursions .
La Société propose aussi quatre excursions à la belle saison (de mai à septembre). L´excursion d´été (fin du mois de juillet ou début du mois d´août) est organisée plus spécialement à l´intention des adhérents qui résident hors du département. Guidées par des spécialistes, elles permettent de mieux connaître les monuments préhistoriques et historiques, civils, religieux ou militaires, les objets d´art, les sites, non seulement du Finistère, mais aussi des départements voisins. Les excursions sont annoncées dans la presse régionale, mais les personnes qui voudraient des informations plus détaillées doivent expédier au siège de la Société cinq enveloppes timbrées à leur adresse.
Sept séances sont organisées chaque année. On peut y entendre des conférences, des comptes rendus d´ouvrages, ou des informations sur la vie de la Société. Elles ont lieu le dernier samedi de chaque mois (quatre de janvier à avril, trois de octobre à décembre). Elles peuvent avoir lieu à Quimper, Brest, Morlaix, Saint-Pol-de-Léon, Quimperlé ou dans une autre ville du Finistère.